Fais ce que je dis... : Le libéral nu.

Je vous avais promis il y a déjà trois mois des éclaircissements sur « la solidarité d'origine et de fait entre l'Etat moderne, l'individu moderne, le capitalisme ». Il va s'agir surtout de choses connues, mais que l'on a tendance à oublier, ou dont on ne perçoit pas assez les conséquences.
On sait par exemple le rôle qu'a joué l'Etat moderne dans l'unification des territoires des différentes nations, qu'à une plus grande stabilité des frontières a correspondu un essor des moyens de transports, dont le symbole est le train, essor qui a permis ou amplifié la création de marchés intérieurs homogènes. Dans le même temps, les décantations successives du concept de nation ont mis l'accent sur la continuité passé-présent, produisant une homogénéité temporelle, symétrique de l'homogénéité spatiale du marché. Double homogénéité à laquelle il faut ajouter l'égalité de principe entre les individus qui forment la nation - a contrario, une société hiérarchisée, où les relations entre les classes sont codées, pose de facto de nombreuses limites à l'extension du marché.
Tout cela je le répète est connu, et par exemple décrit avec subtilité (car l'individualisme joue ici un rôle pour le moins complexe) dans le chapitre « Le retour du politique » du livre de M. Gauchet, L'avènement de la démocratie II. La crise du libéralisme. (Gallimard, 2007, pp. 161-208), auquel je me permets de vous renvoyer. (Je profite de l'occasion pour faire une petite mise au point sur « Marcel et moi » à la fin de ce texte.)
Ce n'est en même temps là « que » une manifestation tardive, quoiqu'essentielle, du processus de constitution de l'Etat moderne, processus qui débute dès la fin du Moyen Age. Je ne peux toujours pas vous offrir une synthèse sur la question, mais un trait essentiel de cette histoire est la séparation progressive (non sans heurts, va-et-vients, paradoxes, décrits par M. Gauchet) de l'Etat du reste de la société, qui devient elle-même dans le même mouvement, on le sait, la « société civile ».
C'est précisément un paradoxe constitutif de cette mécanique de séparation que je voudrais aujourd'hui décrire.

Embrassons hardiment l'ensemble des penseurs politiques européens des XVIIe-XIXe siècle, en laissant de côté ces deux cas particuliers toujours gênants que sont Hobbes et Rousseau, que constatons-nous ? Une préoccupation quasi-constante pour limiter la place de l'Etat. Mais si on la limite, c'est qu'il en a une, c'est aussi simple que ça, et c'était là, depuis la fin du Moyen Age, la nouveauté. Je vous renvoie à l'excellent petit livre de Michel Senellart, Machiavélisme et raison d'Etat, XIIe-XVIIIe siècles, PUF, coll. « Philosophies », 1989, pour plus de détails sur cette intéressante histoire qui se déroule, pour prendre une périodisation quelque peu atypique par rapport à nos schémas de pensée habituels, entre le XIIe et le XVIIe siècles. Résumons cette histoire à grands traits et, comme c'est l'usage à ce comptoir, dans un esprit inspiré par Louis Dumont.
Prenons une société traditionnelle, en l'occurrence la société féodale occidentale. Ce n'est pas que l'Etat n'a pas de fonction propre, le prince des devoirs caractéristiques, etc. L'important, c'est que la société dans l'ensemble, Etat compris, est organisée suivant certains principes (religieux, hiérarchiques...), qui, au moins en théorie, s'imposent à tous. L'Etat a des fonctions particulières, oui, mais il est imbriqué à l'ensemble de la société.
Pour de multiples raisons, la « dynamique de l'Occident » va amener petit à petit à constituer l'Etat comme un domaine séparé du reste de la société. Comme on sait - et là encore, M. Gauchet l'explique très bien - c'est en utilisant les thèmes religieux traditionnels que l'Etat va s'émanciper et se constituer son domaine propre, ce sera une des fonctions historiques de la monarchie de droit divin : c'est en utilisant la thématique religieuse que le pouvoir royal gagnera, de fait, son autonomie, sur laquelle on ne pourra plus, par la suite, revenir.
Il est très important de noter ici que ce mouvement est contemporain des premières pensées d'un domaine économique lui-même autonome par rapport au reste de la société. M. Senellart le démontre, ce sera, reprenons les mêmes termes, la fonction historique du mercantilisme.
A la fin du XVIIe siècle l'essentiel du travail est déjà fait : l'Etat moderne, tout imprégné qu'il soit de souveraineté religieuse, n'est plus partie intégrante de la société, il est devenu un métier à part (citons M. Sennellart : "On voit s'esquisser..., dans le discours sur l'art de gouverner, la transformation de l'office du prince, centré traditionnellement sur ses devoirs, en « métier de roi » (Louis XIV) fondé sur un savoir propre. Mutation qui correspond, avec la montée de l'absolutisme, aux progrès de l'Etat administratif." (p. 57)). Et du sein de ce que l'on n'appelle pas encore la « société civile » - les vieilles féodalités ne sont plus dans le sens de l'histoire, mais elles sont toujours en place, encore puissantes. Ce sera, au moins en France, le travail du XVIIIe siècle de les faire pourrir, avant de leur donner le coup de grâce en 1789 - émerge ce curieux domaine qu'on appelle l'économie.
Oui, à la fin du XVIIe siècle l'essentiel du travail est déjà fait : les penseurs du XVIIIe siècle, et notamment ceux que l'on appelle les premiers libéraux, arrivent sur un terrain déjà bien déblayé. Ce qui ne veut pas dire que leur apport n'est pas significatif, loin s'en faut : ils vont justement, par leurs analyses et leurs prescriptions (pas toujours aisées à distinguer les unes des autres : tout réalistes proclamés qu'ils soient, les libéraux (les « premiers » comme leurs successeurs) prennent souvent leurs désirs pour des réalités et confondent allègrement faits et valeurs), formuler explicitement ce qui était dans l'air sans que l'on en ait bien conscience, et accélérer ainsi l'évolution en cours.
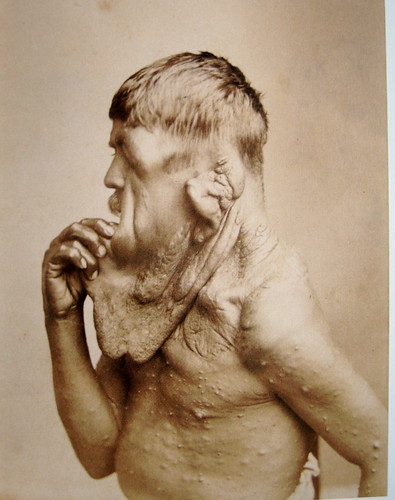
Ils le feront par le versant « société », par le versant « économie », qu'ils vont sinon assimiler complètement l'un à l'autre, du moins rapprocher autant que faire se peut, mais ils savent que le versant « Etat » n'en existe pas moins. Sentent-ils qu'en se concentrant sur la société ils accentuent la séparation Etat-société que les siècles précédents avaient contribuée à créer ? Je ne connais pas assez de première main ces auteurs pour l'affirmer, mais ma thèse du jour est la suivante : de façon plus ou moins consciente, si, entre le XVIIe (Locke) et le XIXe (avant, pour nous donner un point de repère, que le marxisme ne prenne de l'importance), les auteurs libéraux passent leur temps à dire qu'il faut que l'Etat en fasse le moins possible et se contente de créer les conditions pour que la société et le marché, la main invisible dans la culotte, s'éclatent comme larrons en foire, ce n'est pas seulement pour une raison basique de cohérence sur point fondamental de la doctrine : c'est aussi parce qu'ils savent, ou qu'ils sentent, non sans crainte, non peut-être sans un certain plaisir, que dans la pratique le mouvement historique auquel ils participent donne à l'Etat plus d'importance qu'il n'en avait auparavant.

Cette ambiguïté constitutive, il faut en décrire les différents aspects, tout en notant qu'ils obéissent tous au même schéma. Au niveau théorique, on aura recours à l'image d'un pays que l'on coupe en deux. Les deux parties peuvent fonctionner en harmonie, ou dans l'indifférence mutuelle, mais il est désormais possible que l'un des deux envahisse l'autre, ce qui était par définition impossible auparavant. L'Etat médiéval, pour reprendre notre exemple (et ce n'est pas le même Etat que dans d'autres sociétés primitives ou traditionnelles, faut-il le préciser...), avait je le répète des fonctions, mais il restait dans sa finalité imbriqué, j'allais écrire, dilué, dans une organisation d'ensemble qui le structurait.
Au niveau historique : que ce soit sur le versant positif (la constitution du marché interne, avec notamment les investissements massifs faits pour désenclaver certaines régions et pour mettre au point un réseau de transports sur l'ensemble du pays (ceci d'ailleurs sans même évoquer, je vous renvoie à Braudel sur ce point, le rôle de l'Etat dans le financement des grandes expéditions commerciales et colonisatrices qui procurèrent tant d'argent et de produits à l'Occident)), ou sur le versant négatif (la mise au pas des, ou de certaines des hiérarchies traditionnelles), on sait bien que c'est d'abord par une grande augmentation de la responsabilité et des charges de l'Etat que s'est traduite la séparation de l'Etat et de la « société civile ».
On répondra : et les banquiers, et les entrepreneurs ? Sans chercher à savoir qui fut, pour tel ou tel investissement, à l'origine et qui contribua le plus à le mener à bien, il faut répondre deux choses, qui recouvrent d'ailleurs encore une fois les aspects positif et négatif du processus. D'un point de vue « négatif », il faut bien insister sur le fait que quel qu'ait pu être le rôle moteur de certaines personnes privées, rien n'aurait pu se faire, sur un plan global, sans une action forte de la part des Etats. D'un point de vue « positif », c'est-à-dire en envisageant le processus dans sa cohérence d'ensemble, il est précisément illusoire de séparer rigoureusement collectivités publiques et personnes privées. Citons une troisième fois F. Fourquet :
"Le capitalisme n’est pas pensable sans l’État ; un capitalisme sans État, c’est comme un sourire sans chat ; on ne peut même pas parler de « symbiose » comme s’il s’agissait de deux entités distinctes, l’une économique et l’autre politique, qui se seraient formées séparément et auraient passé une alliance ou décidé de vivre ensemble ; il y a inhérence réciproque : dès leur naissance au Moyen Âge, l’État est dans le capitalisme et le capitalisme dans l’État ; ensemble ils forment une seule et même entité sociale."
Il n'y a là aucune contradiction avec la séparation de l'Etat et de la « société civile », il n'y aurait contradiction que si justement l'on assimilait société et « société civile ». Rappelons-le encore, c'est au même moment que l'Etat se sépare de la société et qu'un domaine appelé « économique » de la société se « constitue », ou en tout cas fait l'objet de théorisations. L'Etat se sépare bien de la société dans son ensemble, en tant que, comme la société médiévale, elle était fondée sur une structuration de différents niveaux, politiques, culturels, religieux..., mais c'est le même mouvement qui aboutit à la constitution de la société civile, qui certes fait face à l'Etat, mais dont les traits ne sont pas indépendants de ceux de l'Etat.
(Pour reprendre mon exemple - qui vaut ce qu'il vaut - d'un pays séparé en deux : les frontières communes de chacun des nouveaux pays ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, elles ne sont pas même liées : elles sont définies l'une par l'autre.)

Il n'y a donc aucun problème à constater que certains, banquiers ou entrepreneurs, naviguent entre Etat et société civile, il n'y a rien d'étonnant à ce que ces deux domaines d'activités, nés en même temps, collaborent. Comme je l'ai déjà expliqué, que certains parmi les entrepreneurs soient ici victimes d'une illusion d'optique est un autre problème, qui n'affecte pas la nature essentiellement incestueuse de la relation entre Etat et société civile.
(En revanche, les slogans du type « moins d'Etat » ont plus de cohérence (je n'ai pas dit plus, ni d'ailleurs moins, de valeur), venant des parangons de la société civile (première manière, pas ce que l'on désigne aujourd'hui sous ce terme), lorsqu'ils s'attaquent à l'autre aspect de l'Etat, l'Etat comme « représentant du peuple ». Dans le cas français, on sait qu'il a fallu, pour parachever la révolution anti-féodale, accentuer l'importance du versant politique de l'Etat, faire des promesses sur son aspect de représentation de la société. Le processus est ici différent : il a fallu le faire, cela est d'une grande importance pour l'histoire de France (notamment), mais ce n'était pas une nécessité logique comme celle qui lie Etat et société civile. L'enculisme occidental à la Bentham n'a pas besoin d'un Etat représentant le peuple, il s'en fout complètement, et bien sûr, cela a plutôt tendance à le déranger que l'Etat soit aussi cela, que l'édifice global repose, tant bien que mal, sur trois piliers et non deux.

Il faut toujours avoir cette distinction en tête lorsqu'on entend des critiques contre l'Etat. De même d'ailleurs, bien évidemment, pour ce qui est de ceux qui se veulent à la fois anti-capitalistes et pro-Etat Providence, qui simplifient abusivement le problème.)
Revenons pour finir à nos idéologues libéraux. Il faut je crois éviter autant que possible de formuler les choses en termes freudiens : culpabilité, inconscient, dénégation... même si cela ne serait pas nécessairement faux pour certains de ces auteurs. C'est l'ambiguïté logique qui est intéressante, pas l'éventuelle mauvaise foi de tel ou tel grand (ou moyen) penseur. Pour que la main invisible fonctionne, il faut l'Etat : il le faut d'un point de vue logique, il l'a fallu d'un point de vue historique (ce qui veut d'ailleurs dire que la main invisible est bien peu efficace par elle-même, mais passons.) Les premiers à avoir appelé l'Etat à leur secours, finalement, les premiers « assistés », ce sont les libéraux (et l'on sait qu'ils ne sont toujours pas les derniers à pleurer maman en cas de problème.) De ce point de vue, donc, leurs appels continuels à la limitation du rôle de l'Etat ne sont pas qu'une conséquence logique de leur croyance à l'harmonie de la société débarrassée des tutelles traditionnelles (harmonie on le sait éventuellement perverse : la fable des abeilles, « vices privés, vertus publiques »...), ils sont aussi, pour employer un terme neutre, la prescience de ce que le système qu'ils prônaient impliquait, avant eux - ce processus de séparation de l'Etat et de la société, ils ne l'ont pas inventé - et plus encore après - ce processus, ils y ont largement contribué - : in fine, des capacités inédites d'extension de l'Etat.

Quelques remarques :
- ici comme dans d'autres domaines, chacun à sa façon Hobbes et Rousseau « écrivent tout haut ce que leurs contemporains osent à peine écrire tout bas », le premier en appelant de ses voeux un Etat fort comme seule « réponse » à la société laissée à elle-même, le second en cherchant à briser cette séparation Etat / société civile et en voulant retrouver la société dans son ensemble derrière la seule société civile ;
- M. Senellart donne quelques indications dans ce sens, il doit y avoir des livres sur le sujet : la statistique apparaît en même temps que l'Etat moderne. Le jésuite Giovanni Botero, auquel est consacré une grande partie de son livre, est ainsi à la fois un fondateur de la raison d'Etat moderne (ou de la raison d'Etat de l'Etat moderne) et un des initiateurs de la statistique. Je m'efforcerai de toutes façons de préciser certains points abordés ici à la hussarde, notamment sur la constitution du domaine de « l'économie », je voulais aujourd'hui insister sur cette espèce d'aveuglement sur soi qui est à la naissance du libéralisme.

Ici, d'ailleurs, je suis tout à fait dans la ligne de Michéa : libéralisme politique = libéralisme économique...
- enfin, sur L'avènement de la démocratie II. La crise du libéralisme, et sur Marcel Gauchet : ce livre, ainsi que le tome 1, La révolution moderne, est plein d'enseignements et traite de sujets très proches de mes principales thématiques. Il me pose néanmoins, outre la longueur des citations que le style de l'auteur m'imposerait, toujours le même genre de problème : les raisonnements et thèses de Marcel Gauchet sont à la fois, donc, très proches de ce que j'essaie de développer ici, et, parfois, très éloignés (même si, par rapport aux textes des années 70 et du début des années 80, la diminution des piques anti-marxistes d'une part, qui « droitisaient » quelque peu, au moins en apparence, leur contenu, la perplexité grandissante de l'auteur devant l'évolution des démocraties d'autre part, font que je me reconnais sensiblement plus dans les deux tomes de L'avènement de la démocratie que dans les travaux contemporains ou préparatoires au Désenchantement du monde). Cette porosité entre des thèses que je soutiens et d'autres qui me semblent plus discutables - parfois au sein d'une même phrase, parfois au détour d'un simple adjectif - fait que, pour ces livres comme pour d'autres textes de Marcel Gauchet, il m'est toujours difficile de les traiter pour eux-mêmes, tant le travail d'analyse devrait être serré et laborieux.
Ceci dit, mon objection de base est en elle-même simple : il me semble que M. Gauchet a une vision trop statique, trop unilatérale, des sociétés traditionnelles (un peu comme Castoriadis d'ailleurs). Il se peut bien sûr, me répondra-t-on que ce soit moi qui les idéalise quelque peu... Quoi qu'il en soit, il m'est, pour toutes ces raisons, plus aisé de creuser de mon côté la découverte et l'analyse de ces sociétés - diverses par ailleurs... -, tout en utilisant ce qui me semble fécond dans les diagnostics de M. Gauchet, c'est-à-dire pas mal de choses, que de me lancer dans une longue analyse de ses livres.
A suivre... Bonne sieste !

Libellés : Bentham, Botero, Braudel, Castoriadis, Dumont, Elias, Enculisme, Fourquet, Gauchet, Hobbes, Locke, Mandeville, Michéa, Rousseau, Senellart, Smith


<< Home