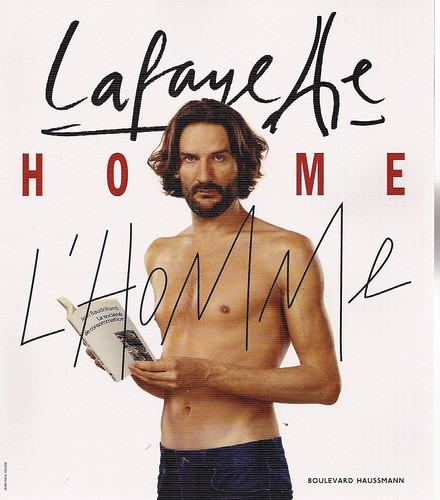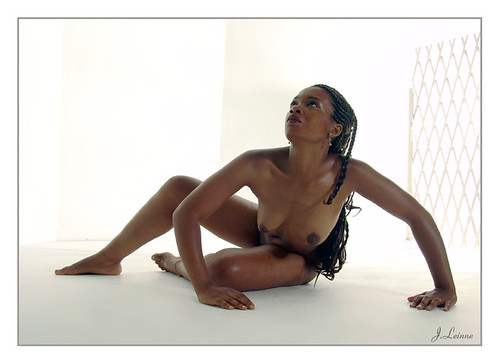"Nous sommes tous Américains", ou comment s'amuser et s'instruire avec les émeutes de banlieue.



Passionnant, réjouissant, impressionnant, effrayant article du Monde dans l'édition datée d'aujourd'hui. Je le reproduis ci-après sans autres commentaires que des images de films de John Carpenter, dont la perception, depuis Assault on Precinct 13 (1978), de la dialectique entre violence tribale des dominés et violence politico-policière des dominants, me semble passablement adaptée aux descriptions contenues dans cet article. J'apporte ensuite quelques précisions et un complément historique.
"Ça sent le gaz lacrymogène, le plastique brûlé et la rage. Celle d'une centaine de garçons bien organisés, qui disent vouloir "buter" le moindre "Schtroumpf" – le moindre policier. Lundi 26 novembre, entre 19 h 30 et 22 h 45, cinq rues de la ZAC et du Puy, à Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, là où, la veille, deux jeunes garçons de 16 et 15 ans, Larami et Mouhsin, sont morts dans le choc de leur mini-moto contre une voiture de police, ont rejoué des scènes d'une extrême violence.
Restés invisibles tout l'après-midi, les policiers se sont postés en masse, en fin de journée, devant la gare du RER D, après l'incendie d'un camion poubelle. A peine les premiers lampadaires allumés, les jeunes attaquent avec des pavés, des feux d'artifice et des pétards "mammouth" – les plus gros.
Dès qu'un policier est touché, les garçons fêtent ça, les bras levés au ciel. Même cri de victoire quand ils reculent. Ils se hissent sur les toits des voitures, ils se prennent en photo avec les téléphones portables.

"Attraper un flic", un "keuf", un "porc" : pendant trois heures, une poignée de meneurs répètent ces mots d'ordre : "Restons groupés!", "Solidaires, les gars !". Et les émeutiers, disciplinés, suivent les consignes.

Les "petits" – certains n'ont même pas 10 ans – jouent les éclaireurs. Ils débusquent les policiers et jettent des cocktails Molotov ; les plus grands veillent à ce que la voie soit libre. Pour enflammer voitures et magasins, ils se ravitaillent aux réservoirs de trois voitures du "95", où sont remplis les jerricans puis les bouteilles de verre. Un gaillard en survêtement noir, talkie-walkie branché sur une fréquence de la police, guide l'équipe.

La troupe sait qu'il ne sert à rien d'attaquer la mairie : elle a fermé ses portes. Le conseil de crise des élus se tient ailleurs, dans un lieu tenu secret.
"Anelka !". Ils se donnent des surnoms de footballeurs, d'animaux ("chameau") ou de héros de télé ("Frelon", alias Bruce Lee). Ils cachent aussi leurs visages. Echarpes haut sur le nez, capuches, et même, pour certains, tenues de CRS, avec matraque et bouclier. Un ami, caméra numérique montée sur pied, filme chaque pavé lancé, dans chaque voiture brûlée. Quand certains s'y croient et s'attardent trop devant l'objectif, les meneurs sermonnent : "Oh les gars, c'est pas du cinéma, c'est la guerre !"

"Allez les frères!", encourage-t-on sur le trottoir, où les anciens, médusés de tant de violence, sont descendus regarder le spectacle, tandis que d'autres tentent de sauver leur voiture. Certaines femmes jettent de l'eau du balcon de leur HLM pour soulager les yeux rougis de leurs "fils". Quand la police charge, certains étages n'hésitent pas à la "caillasser".
Au sol, toute arme est bonne à prendre : des multiprises, une épée, un fusil à pompe… Mais la plupart se battent avec des bâtons en bois ou des barres de fer chipées dans les chantiers. On s'approvisionne en bouteilles dans les silos de recyclage du verre. Panneaux d'affichage électoral ou de signalisation, poteaux, arbres servent d'arme ou de bouclier. Des coins entiers se retrouvent dans le noir, comme l'avenue du 8-mai-1945. Parfois, un coup de pied dans les lampadaires crée un court-circuit.
Tas de pierres et de poubelles bloquent certaines routes, comme des check-points de fortune. "La guerre, c'est ça mon pote. C'est faire tourner en rond l'ennemi", lance un meneur, s'improvisant général.

Comme la veille, certains magasins, certaines concessions automobiles passent à travers les flammes : avant de mettre le feu, on discute.
"Celui-là, il est à la famille", crie une jeune voix devant le pressing du 8-mai-1945. La bibliothèque Louis-Jouvet, le supermarché Aldi, le salon de coiffure, l'auto-école ont moins de chance : pillés et incendiés, pour le dernier par un gamin âgé d'à peine 13 ans. "Faut brûler nos amendes", lâchent-ils en chœur. C'est chose faite à 22h30, lorsque "les impôts" prennent feu.
La jeunesse de Villiers est dehors depuis longtemps. L'après-midi, on a photocopié à la hâte les portraits des deux adolescents "morts pour rien" : le même cri de ralliement qu'après le drame de Clichy-sous-Bois, en octobre 2005, lorsque deux jeunes gens avaient trouvé la mort dans un transformateur électrique. Les collèges et les lycées se sont donnés le mot pour une "marche silencieuse" – si l'on peut dire : dans cette ville proche de Roissy, c'est rare qu'un long-courrier laisse la ville tranquille. Elèves et grands frères, bonnets ou capuches, sacs à dos sur lesquels ils ont fièrement écrit, au Tipp-Ex, le nom de leur cité, entre trois "killer" et deux "fuck the cops", une masse défile.
Frères, sœurs et copains expliquent : "Les policiers n'avaient pas à partir, on aurait laissé passer les secours!" Un grand râle : "Vous allez voir qu'ils vont lancer le débat sur les mini-motos, pour faire diversion. Mais est-ce qu'on fait une histoire quand à Neuilly un cavalier ne porte pas de casque ?"
Dans la foule tendue et sans larmes, on compte aussi quelques profs, bouleversés, mais un seul élu, sans écharpe, – Rachid Adda, conseiller régional (MRC) d'Ile-de-France – et des responsables associatifs, atterrés par ce nouvel épisode de guerre entre jeunes et police. "Moi j'ai vécu Charonne, le 17 avril 1961. Mais la police, ça restait quand même police secours, rumine ce fonctionnaire de mairie. Aujourd'hui, mes enfants je leur dis : quand tu vois la police, tu t'enfuis" ."
Aujourd'hui, mes enfants, je pense au vieux slogan de Siné durant, justement, la guerre d'Algérie : "Si vous trouvez un flic blessé, achevez-le."
Je constate dans cet article un évident chantage à la bavure de la part des émeutiers, les "schtroumpfs" ne pouvant risquer de tuer un gamin de dix ans, cela ferait de nos jours quelque peu tache.
Chantage qui a sa contrepartie, puisqu'il n'est pas rare de nos jours d'entendre d'"honnêtes gens", si exaspérés de ce qu'ils estiment être de l'impunité, en venir à considérer que des gamins morts à la suite d'un délit "n'ont eu que ce qu'ils méritaient", ce qui revient à admettre la peine capitale pour vol de voiture ou braquage.
Je rêve au sort que les rebelles de Escape from New York (1981) font subir au président des Etats-Unis

- on peut transposer.
Et je sais que dans ces cas-là, lorsque la fête est finie, le réveil peut être difficile.

Un complément historique peut n'être ici pas inutile. D'une part permettra-t-il de remettre à leur modeste place les événements décrits plus haut, d'autre part rappellera-t-il qu'aux révoltes répondent les répressions. Je vous laisse faire les transpositions que vous estimez utiles entre les deux situations décrites ci-après et l'actualité des jours derniers (et à venir ?) :
"On peut établir un parallèle entre les événements atroces qui se déroulèrent à Nantes et aux alentours pendant la guerre de Vendée et ceux qui eurent lieu à Paris et aux alentours pendant la Commune. Le fait même de la guerre civile joua un rôle capital dans les deux cas : en 1793, la Vendée se révolta contre le régime contesté de Paris ; en 1871, la capitale se révolta contre le régime contesté qui avait déplacé son siège à Versailles. En mars 1793 comme en mars 1871, une explosion populaire spontanée et destructurée ne s'intensifia que progressivement pour donner naissance à un soulèvement organisé. Dans les deux cas, les dirigeants inquiets considérèrent les insurgés comme des brigands sauvages et cruels : ils fustigèrent d'abord les prêtres et les femmes comme les pires scélérats parmi les Vendéens, puis les anarchistes et les pétroleuses parmi les communards. L'appel à la tolérance du général Haxo à la fin de 1793 n'eut pas plus de succès que celui des avocats du compromis en avril 1871. La méfiance et la haine réciproque ne cessèrent de grandir, les rebelles de 1793 glorifiant le prêtre et l'Eglise, et ceux de 1981 les profanant au contraire, dans des conflits à forte teneur religieuse au sein des deux camps. L'insurrection vendéenne luttait contre les menaces que semblait faire peser une ville anticléricale et agressive, et elle fut vaincue par Paris ; la Commune combattait les menaces que l'on attribuait aux hobereaux et aux monarchistes cléricaux de Versailles, et elle fut vaincue par la campagne. Les rebelles de la Vendée et de la Commune restèrent à peu de chose près coupés du reste de la France et de l'Europe, ce qui les obligea à affronter sans aide les armées de la fragile Première République pour les premiers et celles de la Troisième République embryonnaire pour les seconds.
Dans les deux cas, on observa un important déséquilibre entre le pouvoir des rebelles et celui d'un régime aux abois, bien décidé à les écraser dans un conflit qui adopta la logique et la violence spécifiques au clivage ami-ennemi. A l'image de la Vendée militaire, la bataille de Paris culmina dans une fureur vengeresse. Au cours de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, les insurgés parisiens furent sans doute plus de vingt mille à trouver la mort, avec moins de neufs cents victimes dans le camp gouvernemental. Les rebelles furent relativement peu nombreux à tomber au combat, la majorité d'entre eux ayant été abattus alors qu'ils levaient les mains pour se rendre ou simplement à la suite de leur capture. Les Versaillais firent en outre près de vingt-six mille prisonniers et procédèrent à l'arrestation de quelque dix mille suspects après la fin des combats. Les prisons de Paris et des environs étant combles, plus de vingt mille prisonniers militaires et politiques furent enfermés dans des pontons au large de Brest, de Cherbourg, de Lorient, de Rochefort et La Rochelle. Malgré des conditions de détention abominables, il n'y eut ni épidémies ni famine, pas plus que de noyades [référence aux pratiques des "Bleus" contre les Vendéens à Nantes].
Cela n'empêcha pas Paris de subir la terreur des représailles. Adolphe Thiers,

chef de l'exécutif du régime indécis et précaire qui succéda au Second Empire, ne faisait pas mystère de la nécessité d'un autodafé moderne. Il déclara que le châtiment qui suivrait la victoire devait être appliqué « légalement et implacablement ». Thiers appelait à une « expiation complète, (...) telle que les honnêtes gens doivent l'infliger quand la justice l'exige », mais il jura qu'elle serait appliquée « au nom de la loi et par la loi ». Vingt-huit tribunaux spéciaux entreprirent d'administrer une justice d'urgence de nature militaire, respectant très vaguement les droits des prévenus. Parmi les trente-six mille accusés figuraient un millier de femmes et six cents enfants de moins de seize ans. Près de dix mille communards furent jugés coupables de toutes sortes d'agissements criminels ou de complicité avec les insurgés. Les tribunaux d'exception prononcèrent quatre-vingt-treize condamnations à mort, dont vingt-trois furent suivies d'effet. Ils condamnèrent également deux cent cinquante et un prévenus aux travaux forcés à perpétuité ou à d'autres peines de longue durée, quatre mille cinq cent quatre-vingt-six à la déportation et quatre mille six cent six à différentes peines de prison. Cinquante enfants furent envoyés en maison de redressement.
Comme les rebelles de 1793, ceux de 1871 n'étaient pas des non-combattants innocents.

Quels que fussent les circonstances et le détonateur de leur premier acte de rébellion, ils prirent des otages et les exécutèrent, ils profanèrent des édifices religieux et des monuments publics, incendièrent des bâtiments nationaux et municipaux, et combattirent les troupes du gouvernement sur les barricades. Néanmoins, après avoir fait appel à une force militaire considérable pour écraser le soulèvement et le noyer dans le sang, le gouvernement d'ordre moral de Thiers lança une vaste opération de vengeance ouvertement pseudo-judiciaire destinée à terrifier et à dissuader d'éventuels héritiers de la Commune. Soutenu par les républicains modérés,

il agit sans tenir compte du fait que la guerre civile était terminée, que la France était en paix avec ses voisins, et qu'il n'y avait à court terme aucun risque de reprise de la révolte ou d'invasion étrangère.
Toute guerre civile, comme toute guerre étrangère, doit s'arrêter un jour. Mais les guerres civiles sont plus difficiles à conclure avec équité et sans vengeance que les conflits internationaux. (...) Ajoutons qu'en Vendée, les Blancs ne possédaient pas d'organe gouvernemental représentatif avec lequel les Bleus auraient pu négocier un cessez-le-feu, sans parler d'un accord."
(A. J. Mayer, Les Furies, Fayard, 2002 [2000], pp. 298-300.)
Y a-t-il une conclusion possible ? Non, puisqu'il s'agissait de rappeler quelques constantes des révoltes violentes dans l'histoire contemporaine. J'ai bien essayé, en revenant à Carpenter, d'imaginer une sortie bucolique, m'identifiant d'autant plus aisément à l'heureux compagnon de cette jolie demoiselle

que l'on m'a souvent prêté une ressemblance physique avec lui. Ceci était manifestement aussi cliché que fleur bleue. Autant donc, lieu commun pour lieu commun, s'identifier à ce cher vieil héros hawksien, et même murayo-hawksien

et comme lui rêver de tout éteindre et de repartir à zéro. "Welcome to the human race !"
Hélas, J. Carpenter comme moi-même en savons trop sur l'impossibilité de la table rase, comme sur l'éternité de la violence.

A bientôt !
Libellés : A. Chemin, Bourdieu, Bree Van de Kamp, Buscemi, Carpenter, Dray, guerre civile, Hawks, Louis Jouvet, Mayer, Moi, Schmitt, Schtroumpfs, Siné, Snake Plisken, Thiers