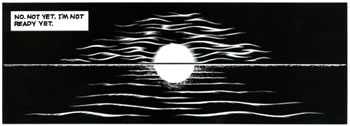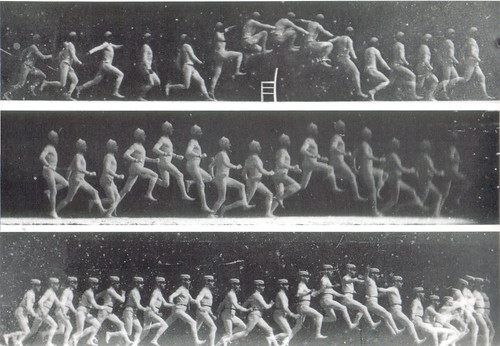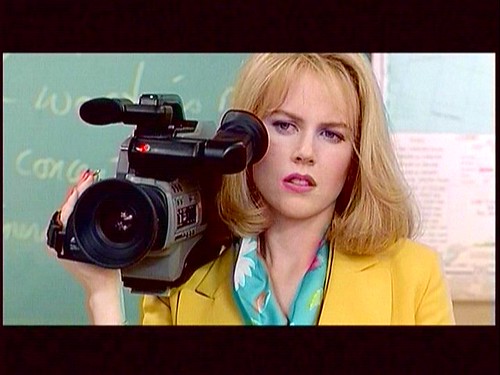(
Ils font cela paraît-il une ou deux fois par an, et pour des durées, répétées pendant trois jours, de vingt à trente secondes. Mieux vaut alors être à ce qu'on fait.)
Ajout le lendemain matin.Ethique et statistique I bis.Ethique et statistique II.Jacques Bouveresse enchaîne :
"Lorsqu'on dit que les événements historiques obéissent aux lois du hasard, on veut dire généralement que leur occurrence dépend de la rencontre d'une multitude de causes qui ont agi d'une manière telle qu'il aurait suffi d'une différence minime dans les causes pour faire tourner les choses de façon maintenant complètement différente. Ce qui a eu lieu aurait très bien pu ne pas avoir lieu et ce qui n'a pas eu lieu avoir lieu à sa place ; et il a tenu généralement à très peu de chose que les événements soient ce qu'ils ont été. Poincaré note : « Le plus grand des hasards est la naissance d'un grand homme. Ce n'est que par hasard que se sont rencontrées deux cellules génitales, de sexe différent, qui contenaient précisément, chacun de son côté, les éléments mystérieux dont la réaction mutuelle devait produire le génie.

On tombera d'accord que ces éléments doivent être rares et que leur rencontre est encore plus rare. Qu'il aurait fallu peu de chose pour dévier de sa route le spermatozoïde qui les portait ; il aurait suffi de le dévier d'un dixième de millimètre et Napoléon ne naissait pas et les destinées d'un continent auraient été changées. Nul exemple ne peut mieux faire comprendre les véritables caractères du hasard ». Le hasard nous semble d'autant plus grand que la disproportion entre la petitesse des causes et la grandeur des effets est plus spectaculaire ; et cette disproportion pourrait difficilement être plus importante qu'elle ne l'est dans l'exemple choisi par Poincaré. Cela signifie que, si l'on est convaincu que l'histoire dépend pour une part essentielle de l'action des grands hommes, alors elle dépend plus que n'importe quoi d'autre du hasard. La naissance de Napoléon a tenu à la rencontre extrêmement improbable de deux éléments que l'on peut supposer, en outre, extrêmement rares. A vrai dire, bien que la plupart des hommes qui naissent soient des individus ordinaires, et non des individus exceptionnels, la naissance d'un individu particulier, quel qu'il soit, avec toutes les caractéristiques précises qui font de lui un être unique, n'est certainement pas en elle-même un hasard moins grand que celle d'un individu génial. Mais comme la naissance d'un autre homme moyen à la place de celui qui est né ne ferait probablement qu'une différence insignifiante, si on la compare à celle qu'aurait fait la naissance d'un individu ordinaire à la place de Napoléon, nous sommes beaucoup plus frappés par le rôle que le hasard a joué dans la naissance de Napoléon et dans les événements historiques qui en ont résulté. Comme la naissance de Napoléon, qui les a rendus possibles et dont on a tendance à croire qu'elle était nécessaire pour qu'ils aient lieu, ces événements étaient à première vue extrêmement improbables et auraient très facilement pu ne pas avoir lieu.

(
La nature est une mécanique de haute précision.)
Les réflexions d'Ulrich sur la probabilité tournent essentiellement autour de la constatation à la fois surprenante et banale que des régularités contraignantes et même une sorte de fatalité inflexible et aveugle peuvent naître de l'absence apparente de toute contrainte : « Avec une sérénité froide et presque indécente, les règles de la probabilité se fondent sur le fait que les événements peuvent tourner tantôt ainsi, tantôt autrement, parfois même auraient pu aboutir au contraire de ce qu'ils sont. Pour former et fortifier une moyenne, il faut donc que les valeurs supérieures ou particulières soient beaucoup moins fréquentes que les valeurs moyennes, qu'elles ne se présentent presque jamais et qu'il en aille de même dans les valeurs anormalement basses ». Dans le monde humain, par exemple, les comportements les plus extrêmes sont (heureusement ou malheureusement) rarissimes, en dépit du fait que, si c'est réellement le hasard qui décide, l'individu devrait en théorie pouvoir aussi bien les choisir que les éviter. C'est, du reste, précisément cette rareté qui fait d'eux des comportements que l'on peut qualifier d'extrêmes. Mais, bien entendu, constater que l'évolution historique dépend, pour une part essentielle, d'actions et d'événements qui pouvaient aussi bien avoir lieu que ne pas avoir lieu et que la seule chose qui importe est finalement le résultat plus ou moins mécanique et complètement impersonnel d'une sorte de « calcul des moyennes » ne suffit pas encore pour conclure qu'elle peut être soumise, ne serait-ce que de façon analogique, aux règles de la probabilité. Comme on l'a vu, les événements de l'histoire humaine donnent l'impression de comporter une part de hasard beaucoup plus grande que nous le souhaiterions et qu'ils ne le devraient pour que nous puissions dire réellement que nous faisons l'histoire. Mais, en même temps, ils ne semblent pas suffisamment fortuits pour relever directement du calcul des probabilités. La difficulté évidente est que le comportement des masses humaines et le cours des événements historiques qui en résulte présentent aussi bien des régularités que des irrégularités caractéristiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles que l'on peut observer sur le modèle simple de l'urne ou du jeu de dés. Ni le grand nombre d'individus qui y sont impliqués ni le fait que les comportements individuels donnent lieu, dans une multitude de cas, qui sont parfois très inattendus, à l'apparition de constance statistiques très remarquables ne suffisent en eux-mêmes à justifier l'assimilation des processus historiques et sociaux aux résultats d'un jeu de hasard." (
L'homme probable..., pp. 143-145).
Après ce petit voyage quelque part entre les testicules de Carlo Maria Buonaparte et les ovules de Maria-Letizia Ramolino (honni soit !), où en sommes-nous ? Il faut être précautionneux, voire besogneux. Commençons par des considérations générales :
- l'histoire des sociétés n'est pas gouvernée par le hasard, au sens où l'on pourrait lui appliquer la théorie des probabilités de façon autre que purement analogique ;
- dans le même temps, « l'évolution historique dépend, pour une part essentielle, d'actions et d'événements qui pouvaient aussi bien avoir lieu que ne pas avoir lieu ».
Stricto sensu, pour qui adhère au
« principe de Bolzano », on peut considérer que cette phrase ne veut rien dire : une fois que l'événement a eu lieu, il ne pouvait pas ne pas se produire. Mais, avant qu'il ait lieu, il est toujours possible, même fort peu, qu'il ne se produise finalement pas. Le
sentiment que nous avons que notre histoire est
en partie gouvernée par l'arbitraire, l'imprévisible, le hasard (dans un sens donc plus vague que dans la théorie des probabilités) n'a donc rien d'illégitime ;
- ce qui fait, nous le verrons dans la livraison suivante, que l'analogie avec la théorie des probabilités n'est pas sans valeur heuristique ni éthique.
Voici un premier bilan. Il reste à se poser maintenant l'autre question qui sous-tend cette série de textes, celle des rapports entre tradition et modernité de ce point de vue du hasard :
- finalement, on a l'impression que cela ne change pas grand-chose -
mais tout de même.... On a vu que ce qui empêche l'application de la théorie des probabilités à l'évolution des sociétés humaines est la capacité, même relative, d'organisation de celles-ci. Une société traditionnelle fortement organisée - on pense tout de suite à l'Inde - dispose donc de garde-fous contre une action trop forte du hasard. Le paradoxe de la modernité, ici comme ailleurs, est que son inclination au conformisme et à l'envie généralisée est une forme d'organisation, qui elle aussi ne permet pas d'appliquer complètement la théorie des probabilités -
mais tout de même...: le mimétisme démocratique est un principe d'organisation moins rigide et en tout cas plus imprévisible qu'un système de castes. Bref, cela ne change pas fondamentalement, mais cela change quand même, et ce n'est pas rien ;
- il est évidemment tout à fait possible, ceci étant précisé, de considérer certaines de ces sociétés comme plus riches de contenu que d'autres, ce n'est pas notre question actuellement ;
- mais il y a aussi la question du sentiment du hasard, tel qu'éprouvé par les acteurs. J'aurais tendance à penser, non sans prudence, qu'il y a ici un paradoxe entre la réalité du rôle du hasard et la façon dont il est vécu. Dans une société traditionnelle reposant, à long terme, sur des principes fixes, ce qui dérange l'ordonnancement global, étant vécu comme une anomalie, peut plus aisément être assimilé au hasard - de même, l'on parle du grain de sable qui vient gripper une mécanique bien huilée, alors que si une machine mal faite ne fonctionne pas, on ne va pas invoquer le dit grain de sable, on va d'abord essayer de l'améliorer. Ainsi quelqu'un comme Saint-Simon est-il fort sensible à cette part d'arbitraire (je retrouve la citation que j'ai en tête dès que possible, croyez-moi sur parole en attendant). Dans les sociétés modernes, qui sont donc peut-être, malgré tout, un peu plus gouvernées par le hasard que les sociétés traditionnelles, ce sont plutôt les régularités qui nous intéressent. La statistique, la sociologie, puis la « nouvelle histoire » naissent en période démocratique - je ne retrouve plus où j'ai écrit cela, mais je l'avais déjà noté pour la sociologie, fortement influencée par Maistre et Bonald à sa naissance : le lien social n'étant plus une évidence vécue, comme il l'était par tout membre d'une société holiste, il devient aussi possible que nécessaire de réfléchir dessus. On peut faire me semble-t-il le même raisonnement avec cet intérêt, dans diverses disciplines, pour les régularités : c'est parce qu'elles ne vont plus de soi (et sont néanmoins présentes, c'est la « constatation à la fois surprenante et banale » d'Ulrich) qu'elles sont objet de réflexion. Autrement dit, ce seraient ceux qui sont le moins soumis au hasard qui y seraient le plus sensibles, et vice-versa - mais cette formule est à utiliser avec précaution et sans systématisme ;
- l'exemple de Napoléon est à cet égard particulièrement bien choisi par Poincaré, puisqu'il fut à la fois le dernier grand homme des sociétés traditionnelles et le premier grand homme de la modernité (et le plus grand grand homme de la modernité, nourri par les grands hommes des sociétés traditionnelles ? et le seul grand homme de la modernité ? Hitler n'en serait qu'une noire caricature ?, etc.), qu'il est donc doublement prodigieux.

Bloy résume ce paradoxe :
"Qu'était-il donc venu faire en cette France du XVIIIe siècle qui ne le prévoyait certes pas et l'attendait moins encore ? Rien d'autre que ceci :
Un geste de Dieu par les Francs, pour que les hommes de toute la terre n'oubliassent pas qu'il y a vraiment un Dieu et qu'il doit venir comme un larron, à l'heure qu'on ne sait pas, en compagnie d'un Etonnement définitif qui procurera l'exinanition de l'univers. Il convenait sans doute que ce geste fût accompli par un homme qui croyait à peine en Dieu et ne connaissait pas ses Commandements. N'ayant pas l'investiture d'un Patriarche ni d'un Prophète, il importait qu'il fût inconscient de sa mission, autant qu'une tempête ou un tremblement de terre, au point de pouvoir être assimilé par ses ennemis à un Antéchrist ou à un démon. Il fallait surtout et avant tout que, par lui, fût consommée la Révolution française, l'irréparable ruine de l'Ancien monde. Evidemment Dieu ne voulait plus de cet ancien monde. Il voulait des choses nouvelles et il fallait un Napoléon pour les instaurer." (
L'âme de Napoléon, Introduction, III.)
Citer ici Bloy n'a rien de fortuit - concernant quelqu'un qui voyait dans le hasard « la Providence des imbéciles », ce serait le comble ! On remarquera en effet, pour finir, et avant que de retomber la prochaine fois dans la grisaille démocratique, que la conception d'un Poincaré du hasard comme d'autant plus présent relativement aux grands hommes, puisqu'il s'agit finalement là de l'itinéraire d'un spermatozoïde au dixième de millimètre près, n'a fondamentalement rien d'incompatible avec une conception providentialiste - fût-ce, dans le cas de Bloy, d'un providentialisme un peu hétérodoxe, avec son Dieu « jaloux » (Introduction, VI) de Napoléon -, que plus elle insiste sur le peu de chance qu'il y avait à ce qu'un homme comme Napoléon naisse, plus elle marque le caractère prodigieux, voire miraculeux, de sa naissance.
Bloy rejoint de plus, par son itinéraire propre, le principe de Bolzano :
"On est, d'ailleurs, suffisamment averti lorsque, étant capable de profondeur, on vient à considérer la sottise palpable d'une substitution imaginaire à des événements accomplis. Tel autre dénouement aurait eu lieu, dit-on, si telle circonstance avait été prévue. Mais précisément cette circonstance ne pouvait pas être prévue ni écartée, puisqu'il fallait ce dénouement et non pas un autre. Les faits sont absolus en eux-mêmes et dans toutes leurs péripéties. Les faits historiques sont le Style de la Parole de Dieu et cette parole ne peut pas être conditionnelle. Il fallait Vincennes, il fallait Tilsitt et Bayonne, il fallait les Rois frères, l'impunité incompréhensible de Bernadotte et la désastreuse campagne de Moscou ; il fallait, après Dresde et Kulm, l'incommensurable folie d'abandonner dans les inutiles forteresses d'Allemagne plus de 150 000 soldats plus que suffisants pour écraser la Coalition dans les plaines de la Champagne. Il fallait enfin Grouchy. Il fallait toutes ces choses connues et beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas, et la preuve sans réplique, c'est qu'elles sont advenues sous l'oeil de Dieu qui ne fait pas de fautes et qui voulait ces choses depuis toujours." (Introduction, XI)

Plus qu'une « preuve sans réplique » on peut voir là un raisonnement circulaire, ou simplement reposant sur le postulat que « Dieu ne joue pas au dés », mais quoi qu'il en soit, à l'arrivée on n'est pas loin de Bolzano : une fois que les faits se sont produits, c'est qu'ils devaient, de toute nécessité (de toute éternité ?) se produire.
Bon, il nous reste encore beaucoup de choses à éclaircir, donc à bientôt !
Je vous mets la vraie pour finir, si ce n'est pas original c'est toujours agréable.

Il fallait Nicole Kidman !
Ajout le 28.05.L'Ahlzeimer de toute évidence me menace, en recherchant dans l'introduction du Pléiade Saint-Simon la référence dont je vous parlais hier, voici que je tombe sur l'exemple le plus canonique possible quant à mon propos :
"Dieu se cache sous le hasard ; le Diable traverse Dieu. La philosophie saint-simonienne de l'histoire (et de la politique) s'inscrit dans
un providentialisme (...) dont la théorie des « petites causes » [est] l'inséparable corollaire. La « fenêtre de Trianon » (une malfaçon est la cause de la guerre de 1688) est un exemple presque aussi connu que le « nez de Cléopâtre », ou la « puissance des mouches » : un détail - une fenêtre un peu de guingois -, par le relais de la psychologie des individus (Louis XIV tire vanité de sa justesse de coup d'oeil ; maître fourbe et grand ambitieux, craignant pour sa place des « Bâtiments », Louvois veut se rendre indispensable), entraîne d'immenses, d'incommensurables suites." (Saint-Simon,
Mémoires, Pléiade, éd. Coirault (auteur de ces lignes), t. 1, p. LVIII-LIX).
Providentialisme et « petites causes »... Il est regrettable que je n'aie pu retrouver ce texte hier, j'aurais pu faire une rédaction plus rapide, et au passage prétendre que j'avais le « nez de Cléopâtre » en tête, quand il ne m'est pas venu à l'esprit une seule fois (quel que soit, d'ailleurs, l'éventuel degré d'ironie que Pascal met dans son affirmation que « s'il eût été plus court... »). Bon, prenons ça pour une confirmation, et ne nous flagellons pas plus que de raison.

(
AMG perdu dans ses réflexions, inconscient du danger...)
Une précision : on aura compris que lorsque je parle des sociétés traditionnelles comme « plus organisées », je parle avant tout, quoique non exclusivement, d'une organisation du sens (seul ce qui a un sens est réel...). Par rapport à nous et dans certains domaines, cela pouvait être un drôle de bordel (j'y pensais en prenant le métro hier soir, univers organisé et codifié s'il en est).
Et tant qu'on y est et puisque je préfèrerais ne pas interrompre cette série de textes par un envoi sur un autre sujet, je signale - merci
M. Radical - cet
entretien avec Jacques Rancière et Judith Revel, entretien dont j'extraie ce passage :
"
J. Rancière : C’est la gauche qui a liquidé 68. En 1981, à peine élu, François Mitterrand déclara qu’avec sa victoire, la majorité politique venait enfin de rejoindre la majorité sociologique du pays. Il entérinait ainsi une définition sociologique de la politique comme coïncidence entre les institutions de l’Etat et la composition de la société. Or, 68 a été un moment politique important parce qu’il a créé une scène politique distante, et des institutions de l’Etat, et des compositions de blocs sociaux. La politique est ce qui interrompt le jeu des identités sociologiques. Au XIXe siècle,
les ouvriers révolutionnaires dont j’ai étudié les textes disaient :
« Nous ne sommes pas une classe. » Les bourgeois les désignaient comme une classe dangereuse. Mais pour eux, la lutte des classes, c’était la lutte pour ne plus être une classe, la lutte pour sortir de la classe et de la place qui leur était assignées par l’ordre existant, une lutte pour s’affirmer comme les porteurs d’un projet universellement partageable. 68 a réactivé cet écart entre la logique d’émancipation et les logiques classistes.
(
J.-P. Voyer, il y a quelques semaines et à quelques jours d'intervalle : "La lutte des classes existe toujours, mais… il n’y a que les capitalistes qui luttent." ; "La lutte de classe (classe au singulier svp) existe, les riches que personne ne défend doivent durement lutter." Cela me fait aussi penser à la phrase de Goebbels à Fritz Lang : "C'est nous qui décidons qui est juif et qui ne l'est pas." : il ne faut pas prendre pour argent comptant les définitions et classifications opérées par le pouvoir (ni croire qu'on puisse ne pas être défini en aucune manière).)
J. Revel : 68 a fait imploser la notion de classe, mais aussi celle d’identité. Ce qui dominait, c’était le plaisir du changement, la métamorphose, le refus de déclarer qui on était. On sortait de la
« morale d’état civil », pour reprendre une belle expression de Michel Foucault. Le paradoxe, c’est que, dans le reflux qui a suivi, on a vu se multiplier les appartenances identitaires, communautaristes. Parce qu’on a cru que c’était un bon moyen de résister ; parce que, du point de vue du pouvoir, paradoxalement, cela facilitait la gestion des individus. La référence identitaire ou communautaire, quand elle se clôt sur elle-même, est une manière de parler la langue du pouvoir, de s’autodésigner dans les catégories mêmes du pouvoir, dans son langage. Aujourd’hui, le seul espace politique de contestation qui soit reconnu, c’est la prise de parole communautaire ou identitaire, et ce n’est bien entendu pas un hasard. C’est une manière de réintroduire de la fermeture et de l’unité là où la puissance politique est au contraire celle des différences.
Lors de la crise des banlieues il y a deux ans, on a assisté à une tentative désespérée de définir qui étaient les émeutiers, le « sujet » de la révolte. On a cherché à constituer des catégories. On a parlé des « Noirs contre les Blancs » ; ou des « immigrés contre les Français ». On a évoqué les désœuvrés, les politiquement aphasiques, les socialement stériles, on a parlé d’entropisation sociale, on les a opposés aux étudiants qui manifestaient contre le CPE, aux chômeurs, aux précaires… Bien plus que les voitures brûlées, c’est cette difficulté à rendre compte de ce nouveau sujet collectif qui a été la cause de la panique qui a saisi les dirigeants politiques. Parce que les émeutiers ne disaient pas qui ils étaient, mais comment ils vivaient."
Suit un passage plus gauchisant et moins intéressant, que je supprime en vous laissant avec ce lien entre ces diverses tentatives de refus des classifications pré-établies, qu'encore une fois on ne confondra surtout pas avec du « spontanéisme ».

Comme Nicole, il faut savoir tenir la barre, éviter tous les écueils...
Libellés : Bloy, Bolzano, Bouveresse, Einstein, Foucault, Gance, Goebbels, Guillermo, Hitler, J. Revel, Kubrick, Lloyd, Maistre, Musil, Napoléon, Nicole Kidman, Pascal, Poincaré, Rancière, Saint-Simon