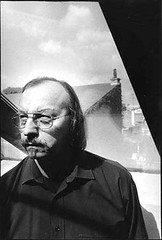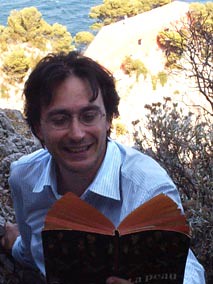Fragments I.Fragments II.Fragments III.Fragments IV.Pour nous remettre dans le délicieux bain holiste, et avant un dernier feu d'artifice, nous allons reproduire et analyser un texte de Jean-Pierre Dupuy, "Individualisme et auto-transcendance", publié en 1989 dans le numéro 86 de la
Revue européenne des sciences sociales. Cela nous permettra en principe de préciser une nouvelle fois ce qui nous rapproche et ce qui nous sépare de Jean-Pierre Dupuy comme de Cornelius Castoriadis, à qui ce texte est en grande partie consacré, de pointer quelques confusions possibles autour du concept de holisme - et de reproduire un texte intéressant, qui à ma connaissance (et j'espère ne pas m'être trompé !) ne figurait pas encore sur le Net.
Mes commentaires seront
en italiques. Selon les goûts, on peut lire le texte de M. Dupuy d'une traite avant de s'attaquer à mes remarques, ou tout lire à la suite. Je supprime quelques passages ici et là, pour éviter d'avoir à fournir de longues explications sur des points annexes, ainsi que les références données par M. Dupuy (je peux les fournir à qui s'en soucie). Les coupures
dans les citations de Castoriadis sont le fait de J.-P. Dupuy et non de moi-même.
"Dans sa discussion des thèses de Max Weber [
j'y fais allusion dans le post-scriptum de de ce texte], Cornelius Castoriadis écrit avec ironie : "Deux choses me remplissent d'un émerveillement toujours renouvelé : le ciel étoilé au-dessus de moi, et l'emprise indéracinable de ces schèmes sur les auteurs contemporains autour de moi." Par "ces schèmes", l'auteur entend les multiples variétés de la pensée qu'il dit "égologique", la méthode individualiste en sciences et en philosophie sociales, qui pose qu'il n'y a de sens que pour des sujets et que seul est compréhensible le produit de l'action individuelle. Pour l'"individualisme méthodologique", dont Castoriadis montre qu'il est aussi, nécessairement, ontologique, les entités collectives ne seraient rien d'autre, en dernière analyse, que le produit de l'action (coopérative et/ou conflictuelle) des individus. Castoriadis prend "brutalement" ses distances par rapport à cette pensée "héritée" : elle est tout simplement fausse. Quant à l'individualisme rationaliste de la tradition anglo-saxonne, il suggère en passant qu'il ne mérite d'être accueilli que par de "durs sarcasmes".
Je dois avouer ici mon embarras. J'éprouve la plus grande admiration pour l'ontologie castoriadienne et le projet politique qui lui est indissociablement lié : projet d'autonomie, autonomie de la société
et autonomie des individus, les deux ne faisant qu'un. Je suis de ceux pour qui la critique du totalitarisme et le grand mouvement libertaire des années soixante et soixante-dix n'auraient pas eu le même sens s'il n'avait été possible de les rapporter au système philosophique de C. Castoriadis. Et cependant, je le confesse, une certaine pensée "égologique" me paraît intéressante et féconde, en dépit, ou plutôt à cause même de ses échecs. C'est pourquoi il me paraît utile d'accompagner cette pensée (...) dans ses avancées les plus significatives, là où elle rencontre sous forme de paradoxes ou de problèmes insolubles ses limites extrêmes, là elle elle se rapproche de ses frontières et donc de ce qui lui échappe, irrémédiablement. C'est d'ailleurs le type d'exercices qui, à d'autres moments, passionne C. Castoriadis, lui qui (je ne crois trahir aucun secret), s'il n'avait été philosophe, aurait aimé être mathématicien (...) Je me contenterai ici de montrer que certaines des vérités ontologiques que Castoriadis reproche à la philosophie égologique d'ignorer ou de nier grossièrement sont en fait accessibles à cette pensée, ou du moins à certaines de ses formes.
Il existe un niveau d'être autonome et irréductible, l'institution social-historique, créatrice d'un sens effectif qui n'est pas sens
pour les individus, mais qui leur est néanmoins compréhensible. Ce sens, que les individus transmettent, dans et par le processus de socialisation, "les dépasse abondamment". Les individus fournissent ainsi l'accès à, "virtuellement, la totalité du monde social chaque fois institué, totalité qu'ils n'ont nul besoin de posséder effectivement (et même, qu'en fait ils ne
pourraient pas "posséder effectivement"). Les individus ne sont pas les seuls à présenter ce mystère de, pourrait-on dire, contenir ce qui les contient : "la langue
comme telle est un "instrument" de socialisation (...) dont les
effets dépassent immesurablement tout ce que la mère, qui l'apprend à son enfant, pourrait "viser"."
Le social-historique, donc, "dépasse infiniment toute "inter-subjectivité". (...) La société n'est pas réductible à l'"inter-subjectivité", n'est pas un face-à-face indéfiniment multiplié, et le face-à-face ou le dos-à-dos ne peuvent jamais avoir lieu qu'entre sujets déjà socialisés. Aucune "coopération" de sujets ne saurait créer le langage par exemple. (...) La société, en tant que
toujours déjà instituée, est auto-création et capacité d'auto-altération..."
De ces thèses affirmées avec force et répétées tout au long de l'oeuvre, on ne saurait évidemment en conclure, sans commettre une énorme bévue, que la philosophie de Castoriadis est "structuraliste" ou "holiste".
-
Ça y est, ça commence... Ainsi que l'utilisation de l'adverbe "évidemment" le laisse soupçonner, cette constatation péremptoire est bien trop rapide. N'entrons pas dans le débat sur le terme "structuraliste", même s'il est important de noter que quelqu'un comme Dumont se considérait à sa manière, qui n'est pas celle de Lévi-Strauss et a fortiori
de Barthes, comme structuraliste. Mais holiste, il suffit de se rappeler l'interprétation de sa pensée par Vincent Descombes, par laquelle nous avions commencé cette série de "fragments", pour constater que Castoriadis peut à d'importants égards être rangé dans cette noble catégorie.Le structuralisme, par exemple, en proclamant la transcendance d'un niveau symbolique autonome en surplomb, accomplit le même geste que les sociétés hétéronomes : il réifie et sacralise, comme la religion selon Durkheim, ce "collectif anonyme, toujours déjà institué" que constitue le social. Il faut revenir à la distinction fondamentale que Castoriadis établit entre "autoconstitution" (ou "auto-institution") et "autonomie". Il y a toujours autoconstitution de la société, même dans une société hétéronome, c'est-à-dire une société qui repose sur la dénégation et l'occultation de sa propre auto-constitution.
-
"Dénégation", "occultation"... J.-P. Dupuy n'a pas tort d'employer ces termes, mais il faut voir ce qu'ils signifient, et il faudrait - c'est facile à dire - le voir pour chaque société existante. Je veux dire par là deux choses, qu'il est important de distinguer :
- ce n'est pas parce qu'une société est hétéronome dans son principe qu'elle est nécessairement moins autonome dans sa pratique qu'une société autonome dans son principe. Castoriadis dit quelque part que dans l'empire chinois les réformes étaient possibles, mais seulement dans le cadre institutionnel de cet empire. C'est une limite, c'est vrai, mais cela laissait déjà une belle latitude. En démocratie aussi il y a des limites - on ne peut supprimer le droit de vote sans sortir du cadre démocratique ;
- ce n'est pas parce qu'une société est hétéronome dans son principe que ce principe d'hétéronomie est sans résidu dans la conscience de ses acteurs. Là encore il faut envisager une question de ce genre en ayant conscience de toutes les possibilités de variation dans le temps et l'espace, mais, d'une part, tout voyageur (Hérodote, Ibn Battuta...) qui a constaté la variété des usages et des moeurs ne peut être complètement prisonnier du principe d'hétéronomie qui fonde sa propre société (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y croit plus), constatation qui peut s'étendre à des couches plus ou moins larges de la société selon qu'elle est en contact plus ou moins régulier avec d'autres sociétés, d'autre part et surtout le principe d'hétéronomie, pour souple et multiple qu'il puisse être (le polythéisme, par exemple) n'explique pas nécessairement tout à chaque instant, pour chaque acteur. Un sauvage qui se prend une pierre sur la figure n'invoquera pas nécessairement le rôle du dieu de la pierre, même si c'est un dieu important pour sa tribu, peut-être préférera-t-il mettre son point dans la gueule au compatriote qui lui avait envoyé cette pierre. Ou bien, différents principes d'hétéronomie peuvent être en conflit dans la société, les compromis que cela dégage étant alors d'autant plus variables à l'échelle des individus : c'est le cas de la conciliation entre christianisme et polythéisme, via
notamment le culte des saints, au Moyen Age. Une telle cuisine me semble-t-il ne peut être acceptée des acteurs sans une certaine distance, plus ou moins consciente certes, et dans cette optique les termes de "dénégation" et d'"occultation" sont tout de même gênants, lesquels laissent à penser que les acteurs n'ont aucun savoir sur ces opérations et dessinent à mon sens une frontière trop nette entre nos sociétés (c'est-à-dire, chez Castoriadis, Athènes et l'Occident actuel) et les autres. Ce qui est préjudiciable à la fois du point de vue théorique et du point de vue politique. Mais, encore une fois, les arguments que je viens de développer sont plus ou moins valables selon les périodes de l'histoire, les classes sociales, etc. Revenons à J.-P. Dupuy.Cette "hétéronomie instituée" a le plus souvent pris dans l'histoire la forme de la religion : il s'agit d'imputer à une source extra-sociale l'origine et le fondement de l'institution. Or, "Dieu n'existe pas, et les "lois de l'histoire", au sens marxien, non plus. Les institutions sont une création de l'homme. Mais elles sont, pour ainsi dire, une création aveugle. Les gens ne savent pas qu'ils créent et qu'ils sont en un sens libres de créer leurs institutions".
-
On aura compris que le même type de réserves peut être émis en ce point.Qu'est-ce donc, dans ces conditions, que l'autonomie ? C'est l'autoconstitution explicite, lucide, réfléchie et délibérée, qui implique une mise en question illimitée de l'institution établie de la société. "Une société autonome devrait être une société qui sait que ses institutions, ses lois sont son oeuvre propre et son propre produit. Par conséquent, elle peut les mettre en question et les changer". Une société autonome n'est évidemment pas une société sans lois ni institutions, car sans ces dernières, il n'y aurait tout simplement pas de communauté humaine possible. Il y a donc une loi posée, du sens institué. Cette loi ne recueille pas nécessairement l'approbation de tous les membre de la société. En sont-ils pour autant moins autonomes de la prendre pour
leur loi ? Non, s'ils ont participé effectivement au processus de formation et de fonctionnement de la loi. S'ils se plient alors à la volonté de la majorité, à la volonté générale, ce n'est pas, bien au contraire, qu'ils cessent d'être libres.
La société autonome n'est donc pas une société transparente à elle-même, et l'autonomie n'est pas la maîtrise. Il y a un écart, un abîme infranchissable entre les individus et le social. Cet écart est une différence ontologique qui sépare deux modalités d'être radicalement distinctes et radicalement irréductibles l'une à l'autre. Et cependant, ce sont les gens, les individus qui créent leurs institutions et, dans une société autonome, les créent lucidement, de façon explicite et réfléchie. Certes, Castoriadis affirme sans cesse que le sujet de la création sociale et institutionnelle, c'est la société elle-même (plus précisément, le social-historique comme strate logique autonome) : il y a
auto-création, et donc auto-altération de la société. Mais, nous l'avons vu, les hommes, comme individus, sont aussi les sujets de cette création. Il n'y a ici aucune contradiction, car les individus sont une fabrication de la société instituée à partir des psychés singulières. La société se crée et s'altère elle-même dans et à travers les individus qui la composent.
-
J'attire votre attention sur cette dernière formulation, nous aurons l'occasion d'y revenir.Nulle contradiction, donc, mais un paradoxe : l'ontologie "feuilletée" qui nous est ici présentée reconnaît des strates radicalement disjointes qui sont néanmoins capables de se compénétrer, le niveau englobé étant à même d'engendrer le niveau englobant parce que celui-ci est déjà à l'intérieur de celui-là - et alors même que le niveau englobant dépasse "infiniment" le niveau englobé.
Or, je prétends que cette forme paradoxale est accessible à la philosophie égologique, à la méthode individualiste, et même à sa version la plus honnie peut-être par Castoriadis, le "crétinisme libéral". Qu'on se rassure : je distingue ici le contenu et la forme, et n'entends nullement assimiler le projet révolutionnaire qui vise l'autonomie individuelle et sociale au laissez-faire et à l'indifférentisme libéral. Il se trouve cependant que les "grandes" philosophies libérales présentent en leur sein le même paradoxe que celui qui structure l'ontologie castoriadienne. On ne saurait donc, sans injustice, les accuser de reposer sur une "métaphysique infra-débile" (
sic).
"Jamais deux sans trois", telle pourrait être la maxime de la philosophie sociale de Castoriadis. "Aussi longtemps qu'il n'y a que deux, il n'y a pas de société. Il doit y avoir un troisième terme pour briser ce face-à-face. Le face-à-face est fusion, domination totale de l'autre, ou domination totale par l'autre. Soit l'autre est l'objet total, soit on est l'objet total de l'autre. Afin que cette sorte de situation absolue, quasi psychotique, soit cassée, on doit avoir un troisième terme." On a ici une structure bien typée : une relation horizontale médiatisée par un tiers (père, maître, institution, langage, loi, etc.) en surplomb, à la verticale, relevant d'un niveau autonome qui néanmoins "sort", en quelque sorte, du niveau inférieur. Castoriadis précise bien que cette structure n'est pas celle de l'
aliénation puisqu'elle vaut pour une société autonome aussi bien que pour une société hétéronome. Il n'y a pas d'autonomie ni de liberté sans cette position de tiers apparemment extérieure et qui pourtant ne l'est pas, puisqu'elle est totalement endogène à la structure. A ne pas affronter ce paradoxe, on risque de tomber dans les positions effectivement débiles d'un Roland Barthes pour qui le langage est essentiellement fascisme et hétéronomie, parce qu'on ne peut en changer les règles à loisir, ou d'un Régis Debray qui excipe des théorèmes logique d'incomplétude pour affirmer l'impossibilité radicale de débarrasser le politique du religieux et la nécessaire extériorité du tiers médiateur. La structure en cause n'est pas la structure de l'aliénation, mais c'est
en elle que l'aliénation peut surgir. L'aliénation n'est pas dans l'existence du tiers, elle
peut être dans le
rapport au tiers : lorsque les hommes, ne reconnaissant pas en lui leur création, le réifient, le sacralisent, en font un totem investi d'un pouvoir magique et traité comme le maître de la signification.
-
A boire et à manger là-dedans, mais nous n'allons pas nous aventurer dans le domaine des relations "quasi psychotiques". Demandons-nous tout de même - c'est une question rhétorique - si la démocratie n'est pas devenue un de ces "totems investis d'un pouvoir magique", et retenons l'heureuse précision selon laquelle l'aliénation, si l'on tient à utiliser ce concept, ne vient pas de l'existence en tant que telle de l'institution, mais d'un certain rapport à elle.A la suite du "crétin libéral" Hayek et de quelques autres, j'ai proposé d'appeler cette forme ontologique : "auto-transcendance". Cette expression désigne le mouvement d'auto-extériorisation par lequel une structure produit, de façon purement endogène, cela même qui la dépasse infiniment, une extériorité qui n'en est pas une puisqu'elle est toujours déjà présupposée dans le constitution même de la structure. Cette logique de l'auto-transcendance, jusques y et compris l'idée que sans elle, il n'y aurait que fusion à la fois identificatrice et conflictuelle, j'ai pu montrer qu'on la trouve à la racine de la pensée d'Adam Smith, père de l'économie politique, pensée "égologique" s'il en fût. Je crois qu'on pourrait montrer de même qu'elle structure les systèmes philosophiques de Walras et de Hayek ; mais aussi ceux de Hobbes, Rousseau, Tocqueville et de bien d'autres représentants de la "méthode individualiste en sciences sociales". Ceci n'est pas un bric-à-brac et il ne s'agit pas, encore une fois, d'assimiler ces pensées les unes aux autres dans leur contenu, mais simplement de repérer en elles une même forme : celle de l'auto-transcendance.
Qu'on en juge sur ce seul exemple. A la fin de sa vie, Rousseau définissait le problème politique, qu'il comparait à la quadrature du cercle, en ces termes : mettre la loi
au-dessus des hommes, alors même que ce sont les hommes qui la font, et qu'ils le savent. C'est parce que et en tant que les hommes obéissent à la loi qu'ils n'obéissent à personne, et donc qu'ils sont libres. (On aura noté bien des accents rousseauistes dans les propositions de Castoriadis qui, d'ailleurs, classe Rousseau dans "la grande philosophie politique"). Or on pourrait exprimer dans des termes formellement semblables le message des théoriciens politiques du marché : c'est parce que et en tant qu'ils se plient aux lois du marché que les individus ne sont les sujets de personne, et donc qu'ils sont libres. Ce sont les hommes qui font, ou plutôt actionnent le marché, et cependant celui-ci les dépasse infiniment.
-
A quel point le parallèle Rousseau-"théoriciens politiques du marché" est fondé en raison, il faudrait le vérifier. Contentons-nous de noter que, à l'instar de ce qu'il faisait dans le texte que j'ai précédemment analysé, J.-P. Dupuy prend ici des exemples statiques, ou faussement dynamiques : la dimension de l'institution comme "toujours-déjà-là", si importante en soi comme chez Castoriadis, s'en retrouve édulcorée. Chez Rousseau tel qu'il le décrit, les hommes se réunissent un jour et décident de faire une loi, comme ça, allons-y, amusons-nous, ça nous changera de l'ordinaire, de même qu'un beau jour ils "actionnent" le marché, et tout commence. Mais tout a toujours déjà commencé.La substitution du marché à la loi n'est certainement pas anodine et l'on peut dire qu'on passe ainsi de la liberté à l'aliénation. Ce point est cependant sans doute discutable, de même qu'on discute encore aujourd'hui de savoir quel est le système le plus totalitaire, celui de Hobbes qui met en position de tiers médiateur le souverain absolu mais admet dans certains cas la désobéissance à la loi, ou celui de Rousseau qui fait de la loi, "expression de la volonté générale", un tiers non moins absolu puisque son système implique que l'on "force les hommes à être libres". Mais de toute façon, là n'est pas la question puisque, encore une fois, l'autonomie et l'hétéronomie ont la même forme : celle de l'auto-transcendance.
Aliénation : le même mot, nous rappelle Paul Ricoeur, a servi à traduire en français deux séries sémantiques distinctes dans la philosophie de Hegel : l'aliénation-extériorisation (
Entäusserung) qui a un caractère éminemment créateur, d'un côté ; et de l'autre, l'aliénation-étrangéité (
Entfremdung), qui désigne la coupure avec soi-même propre à la "conscience malheureuse". Cette difficulté terminologique illustre bien ce point essentiel fortement mis en lumière par Castoriadis : l'auto-extériorisation peut être le lieu de l'aliénation (dans son second sens, négatif), elle n'est pas, par elle-même, bien au contraire, aliénation (dans ce second sens).
-
Voilà une vérité que tous les gauchistes devraient méditer. Mais alors ils ne seraient plus gauchistes. Une telle Entäusserung
ne leur ferait pourtant pas de mal, à toutes ces "consciences malheureuses".Qu'on m'entende bien. Je ne prétends pas réduire l'ontologie de Castoriadis à la seule forme de l'auto-transcendance. Ce n'en est qu'un aspect et il en est d'autres, fondamentaux, que la "pensée héritée" et la philosophie "égologique" ignorent totalement : création, imagination radicale, imaginaire social-historique et société instituante, magma, ce sont des idées qui appartiennent en propre à l'auteur de l'
Institution imaginaire de la société, et il faut lui savoir gré d'avoir montré les limites de toute pensée qui ne les prendrait pas en compte. Inversement, le fait de reconnaître dans un système philosophique la forme de l'auto-transcendance n'implique pas qu'on le tienne ipso facto pour intéressant et fécond. Il est vrai qu'il y a chez Hayek des légèretés inacceptables et que ses conclusions éthiques et politiques sont difficilement soutenables. On ne doit pas pour autant oublier ceci : la philosophie égologique a des ressources étonnantes, et comme la capacité de se dépasser elle-même en un
bootstrapping qui mime le mouvement d'auto-extériorisation dont il est ici question. Mon enquête (ma quête)
-
Prétentieux ! Poseur ! Voilà un tic de langage révélateur, ou je ne m'y connais pas. Et j'ai fréquenté assez d'universitaires, pauvre de moi, pour m'y connaître.personnelle vise à comprendre la nature exacte de ces ressources et à évaluer leur étendue. Quoi qu'il en soit, on ne saurait, sans la caricaturer, présenter la méthode individualiste en sciences sociales comme le fait parfois Castoriadis. Il est vrai que, trop souvent, elle est la première à offrir une caricature d'elle-même. Mais il n'est pas vrai que les meilleurs de ses penseurs mettent en scène cet individu autosuffisant, défini antérieurement à, et en dehors de toute société, dont parle Castoriadis. Chez Smith comme chez Hayek, pour ne citer qu'eux, sans la société que pourtant il contribue à faire et qui le dépasse absolument, l'individu ne serait rien. Il faut prendre garde à ne pas confondre l'individualisme méthodologique et le psychologisme. Comme Popper le souligne depuis longtemps, et comme Alain Boyer nous le rappelle, "l'individualisme méthodologique est compatible avec la thèse de l'autonomie de la sociologie par rapport à la psychologie et donc avec elle de l'autonomie du social par rapport à la psyché."
-
Tout cela est bel et bon, mais lorsqu'on creuse un peu les choses, comme j'ai essayé de le faire dans le fragment précédent, on a l'impression que ce sont surtout des mots. Je n'y reviens pas.La
logique ensembliste-identitaire est-elle capable de conceptualiser, voire de formaliser l'auto-transcendance ? C'est là un débat passionnant, qui a opposé Cornelius Castoriadis à deux biologistes, théoriciens de l'auto-organisation, Henri Atlan et Francisco Valera, lors du colloque de Cerisy de 1981 consacré précisément à ce thème : "L'auto-organisation. De la physique au politique" [
Seuil, 1983]. Je ne reviendrai pas sur cette discussion mais rappellerai simplement ceci (...) :
On sait aujourd'hui que les objets mathématiques les plus intéressants sont rebelles à toute définition génétique. Bien qu'ils soient
faits par le mathématicien (les définitions et les démonstrations sont bien constructivistes), leur définition n'épuise pas l'ensemble de leurs propriétés. Considérons par exemple cet objet défini sans la moindre ambiguïté et que l'on est capable de construire étape par étape : l'ensemble des théorèmes que l'on peut démontrer à partir d'un ensemble fini d'axiomes donnés, selon un ensemble de règles d'inférence données. Il est en général impossible de caractériser cet objet de façon effective, c'est-à-dire mécanique, alors que c'est de manière mécanique qu'on le construit. Il n'existe aucun mécanisme tel que si on lui présente une proposition donnée quelconque, il répondra à coup sûr : oui, c'est un théorème, ou : non, ce n'en est pas un. Tout ce qu'on pourra faire, c'est dérouler mécaniquement, un par un, l'ensemble des théorèmes, en attendant de voir apparaître soit la proposition en cause, soit sa négation. Or il existe des propositions, dites "indécidables", pour lesquelles ce ne sera jamais le cas.
En termes techniques : bien que récursivement énumérable, cet ensemble n'est pas récursif. Ce résultat est philosophiquement prodigieux car il signifie que la définition que l'on donne de cet objet en se donnant le mécanisme qui l'engendre ne suffit pas à caractériser de façon mécanique l'objet en question. L'objet est (infiniment) plus complexe que le mécanisme qui l'engendre. Un mécanisme peut donc être (infiniment) dépassé par cela même qu'il produit. C'est du moins ainsi qu'à la fin des années cinquante, John von Neumann interpréta les théorèmes logiques d'incomplétude en formulant sa célèbre conjecture sur la complexité. Dans l'univers des machines (abstraites), il existe un seuil de complexité, supposait-il, tel qu'au-delà, il soit (infiniment) plus simple de construire la machine que de décrire complètement son comportement. Ce dont est capable un mécanisme complexe est (infiniment) plus complexe que le mécanisme lui-même. La matrice est (infiniment) dépassée par sa descendance. Ou encore : le modèle le plus simple de l'objet complexe, c'est lui-même (c'est aussi de cette façon que l'on définit aujourd'hui un objet aléatoire, c'est-à-dire un "automate" au sens aristotélicien.)
Etre complexe, c'est être capable de complexification. Von Neumann, fondateur de la théorie mathématique des automates, résolvait ainsi le paradoxe quasi théologique qui s'exprime dans la volonté de "construire un automate" - c'est-à-dire être la cause d'un être qui, par définition, est cause de soi. Si l'automate est un être "complexe", je le construis, certes, mais son comportement m'échappe - et, en un sens, il échappe aussi à l'automate lui-même.
-
Le parallèle avec Adam et Eve vient spontanément à l'esprit - Dieu dépassé par les êtres finalement complexes qu'il a créés -, mais ne sortons pas de notre sujet.La conjecture de von Neumann a une portée ontologique considérable. Elle rend par exemple non contradictoires les deux propositions suivantes : 1) Des mécanismes physico-chimiques sont capables de produire la vie ; 2) la vie est (infiniment) plus complexe que les mécanismes physico-chimiques qui l'ont engendrée. Il est donc possible d'avoir une ontologie non substantialiste (ici, non vitaliste) qui garantisse néanmoins l'irréductibilité de la strate produite par rapport à la strate productrice.
Considérons, de façon analogue, les deux propositions : 1) ce sont les hommes qui font (ou plutôt : "agissent") leur société ; 2) la société les dépasse en ce qu'elle est (infiniment) plus complexe qu'eux. Elles caractérisent une tradition philosophique qui, des "Lumières écossaises" à Hayek, considère le social comme un automate complexe, un "ordre spontané" qu'aucune volonté n'a voulu, qu'aucune conscience n'a conçu, comme si cet ordre était mu par une "main invisible".
-
Que l'on pardonne à mon imagination (radicale), mais cette expression m'a toujours parue impie - quelque chose comme Dieu giving himself a treat
, de surcroît sur notre dos. Je ne sais pas si le pourtant très masochiste - et d'un masochisme hélas pour nous fort contagieux - Adam Smith aurait accepté une telle interprétation.L'autonomie de la société, pour cette tradition, cela signifie que la société n'obéit qu'à ses lois propres, étrangère aux efforts que les hommes déploient pour la maîtriser, alors même que ce sont eux qui la produisent. Il est intéressant de noter que pour éclairer cet apparent paradoxe, Hayek a eu précisément recours à la notion de complexité, au sens de von Neumann, et à ses avatars ultérieurs (théories de l'auto-organisation). On voit ici la possibilité de penser l'irréductibilité du social par rapport aux individus sans pour autant faire de celui-ci une substance ou un sujet - ce que fait évidemment Castoriadis lorsqu'il dit de la société qu'elle "sait", qu'elle "oeuvre", qu'elle "met en question" ou qu'elle "s'altère".
-
Et voilà ! Patatras ! Tout s'écroule ! Truffe ! Ce n'est pas la peine de se lancer dans des développements si impressionnants et si scientifiques, si c'est pour en tirer une conclusion aussi fausse, comme par hasard ponctuée du même "évidemment" que tout à l'heure. Toute la question, précisément - et elle sera reprise une nouvelle fois dans le prochain "fragment" -, est de savoir jusqu'à quel point on peut légitimement employer de telles expressions (qui, je le rappelle, ne semblaient pas gêner Jean-Pierre Dupuy lorsqu'il exposait la pensée de Castoriadis au début de ce texte). Quoi qu'en dise notre auteur, si ces expressions ne sont jamais légitimes, alors on retombe dans l'individualisme méthodologique le plus plat et le plus stérile, habillé façon pasteur protestant (Smith) ou façon logicien léniniste (Hayek), et on se borne à constater, considérable avancée théorique !, que les actions des hommes n'aboutissent pas toujours aux résultats escomptés. J'exagère à mon tour ? A vous de voir, mais même en l'admettant, il faudrait alors expliquer pourquoi nos si brillants et boostrappers
libéraux aboutissent si souvent à des positions politiques débiles. C'est justement le point que J.-P. Dupuy aborde maintenant.Il est inutile d'insister sur le fait que la philosophie politique de Castoriadis n'a rien à voir avec celle de Hayek, pour dire le moins. Ce que celui-ci nomme autonomie est hétéronomie pour celui-là. Il n'en est que plus remarquable de trouver dans l'épistémologie sociale de Hayek des propositions que l'on croiraient sorties de la plume de Castoriadis. Pour l'un comme pour l'autre, il y a dans le social du savoir, du sens qu'aucune conscience individuelle ne peut s'approprier car il la dépasse absolument. Et cependant, les individus ont accès à ce sens : ils le "comprennent" - et, en un certain sens, ils l'incluent : ils contiennent en eux cela même qui les dépasse. Dans l'un et l'autre cas, nous avons la figure de l'auto-transcendance.
-
Aaargh... J.-P. Dupuy va lui-même corriger en partie ces coupables imprécisions.Comment apprécier ce qui, tout à la fois sépare absolument et unit ces deux auteurs (et sans préjudice de ce que, certainement, l'un et l'autre tiendraient le rapprochement pour scandaleux) ? Je suggère la piste de réflexion suivante. Chez Castoriadis comme chez Hayek, l'ontologie et la philosophie politique se présentent comme étroitement solidaires. Ils sont cependant amenés à mettre l'accent tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre. Il semble que ce soit à des endroits exactement symétriques. Soit, une fois de plus, les deux propositions suivantes, dont le flou est suffisant pour qu'on puisse dire que l'un et l'autre de nos deux auteurs les tiennent pour vraies : 1) les gens créent leur société ; 2) la société qu'ils créent les dépasse infiniment. Dans son ontologie, Hayek insiste sur 1) (c'est la clé de son nominalisme et de sa philosophie égologique), et dans sa politique, sur 2) (ce que les hommes ont de mieux à faire est de préserver les ordres spontanés et de s'appuyer sur le savoir que ces ordres mobilisent mais qu'eux, les hommes, ne peuvent posséder). C'est proprement l'inverse chez Castoriadis. Son ontologie met l'accent sur 2), puisque c'est l'une de ses découvertes fondamentales (la société instituante comme créatrice d'un monde de significations imaginaires sociales)
-
et Durkheim, et Mauss, ils puent des pieds ? Je serais Jean-Claude Milner, à Yahvé ne plaise, j'aurais vite fait d'intenter au pauvre J.-P. Dupuy un procès en antisémitisme. Bon, ne chipotons pas.et sa politique sur 1), lorsqu'il s'agit de porter le projet révolutionnaire d'une société autonome, faite d'individus autonomes, mettant en question de façon illimitée l'institution établie. On aboutit alors au paradoxe suivant : si l'on ne considère que la dimension politique (ce qui mutile, certes, l'oeuvre de l'un et de l'autre), l'individualisme semble être du côté de Castoriadis et la pensée de l'autonomie et de l'irréductibilité du social semble être du côté de Hayek. Il est d'ailleurs probable que celui-ci tienne, s'il la connaît, la pensée de celui-là, pour le comble du "constructivisme", c'est-à-dire de l'hybris individualiste.
-
Point de vue que, pour des raisons certes différentes, nous partageons en partie, ainsi que nous l'avons explicité dans un de nos premiers commentaires.Cette remarque éclaire peut-être l'étrange débat qui a opposé Castoriadis à Luc Ferry et Alain Renaut à propos de l'interprétation de Mai 68. Dans un premier moment, ces derniers avancent deux thèses surprenantes : Mai 68 prépare le triomphe de l'individualisme narcissique ; il n'est pas étonnant que ce mouvement social soit contemporain des idéologies de la mort de l'homme, car l'individu n'est point le sujet autonome dont on célèbre les funérailles, mais sa dégénérescence et sa négation. Castoriadis, dans un deuxième moment, conteste radicalement cette analyse : Mai 68 a représenté une étape, certes vite effacée, sur le chemin révolutionnaire de lutte pour l'autonomie, individuelle et sociale ; la critique idéologique de la subjectivité a accompagné, non pas Mai 68, mais sa décomposition et son échec : nous n'avons pu faire advenir le sujet autonome, il est réconfortant de savoir qu'il était de foute façon décédé.
-
Très bien vu Cornelius, et merci.Voici ce qu'il écrit : "Ce qu'on appelle maintenant l'"individualisme" est pour l'essentiel ce que j'ai appelé, depuis 1959, la privatisation. Il était présent bien avant Mai 68. Le mouvement de Mai 68 était, au contraire, une réaction contre cette évolution. Après l'interlude de Mai, la privatisation a refleuri de plus belle. Les idéologies de la mort du sujet, de la mort du sens, qui jusque-là se propageaient entre la rue de Lille et la rue d'Ulm, ont alors inondé le marché populaire des idées : c'est qu'elles étaient des formes de théorisation de l'échec du mouvement." (in Un monde morcelé
, Seuil, 1990, dans un texte de 1987 dont je n'ai pas noté la référence.)Cependant, dans sa contestation, Castoriadis semble d'accord avec Ferry et Renaut sur un point capital : la mort du sujet allant de pair avec la montée de l'individu, c'est donc bien qu'une différence radicale les sépare. Dans un troisième moment, répondant à Castoriadis et cherchant à rendre plus plausible leur thèse paradoxale, Ferry et Renaut sont amenés à redéfinir l'individualisme, de telle sorte qu'il englobe, comme une de ses modalités particulières, la quête de l'autonomie au sens de Castoriadis. Le sujet autonome devient une espèce particulière du genre individu. La philosophie de Castoriadis se révèle être une philosophie égologique.
Sans doute y a-t-il encore du travail à faire si l'on veut éclaircir les rapports complexes entre l'individu et le sujet autonome (au sens kantien comme au sens de Castoriadis)."
-
sans doute, oui... Concluons à notre tour. C'est en ce point que le "fanatique modéré" Vincent Descombes, que l'on imagine volontiers stimulé par la lecture de ces dernières lignes, et qui réserve dans ce livre un traitement de choix à Alain Renaut, prend le relais et s'efforce de procéder à de tels "éclaircissements" dans son Complément de sujet. Enquête sur le fait d'agir de soi-même
(Gallimard, 2004). Nous y reviendrons la prochaine fois.
Deux rappels pour conclure.
Je suis bien conscient que s'attaquer à l'oeuvre de Castoriadis en passant par l'intermédiaire d'un texte que l'on ne trouve pas toujours assez précis est quelque peu expéditif : il me semble néanmoins que, rapport à ce qui me gêne le plus chez Castoriadis, le texte de Jean-Pierre Dupuy était un bon point de départ.
Comme je ne l'avais évoqué que lors d'un commentaire, signalons "officiellement" le colloque consacré à M. Dupuy qui va se tenir à Cerisy en juillet prochain, en présence notamment de Vincent Descombes, René Girard et Henri Atlan. Je ne pourrai hélas m'y rendre, mais avis aux amateurs...
Au plaisir !Libellés : Atlan, Barthes, Castoriadis, Descombes, Dumont, Dupuy, Durkheim, Ferry, Hayek, Hegel, Hobbes, holisme, Mauss, Milner, Renaut, Ricoeur, Rousseau, Smith, Tocqueville, Walras